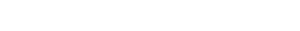« Ces livres de malades, de malades métaphores qui, comme Fritz Zorn, s’inventèrent écrivains afin de vivre une vie à laquelle pouvoir mourir quand frappe le cancer, est-ce cela l’expérience dont on parle quand on dit, à propos de leur lecture, cela me fait du bien ? Non, cela me fait exister en me portant auprès de la mort, cela me fait entrer dans la connivence littéraire de la maladie. Cela agrandit une vie en dressant la toile sur laquelle elle fait fond. Cela alourdit de vie la mort et de mort la vie. Cela me permet de penser que ma mort à moi sera possible. Autrement, ce sera la mort, une mort, sans vie, sans personne, sans vérité. » Prenant le parti ingouvernable de l’étrange, liseur d’Artaud, de Duras, d’Acker, de Genet, de Mann et, bien sûr, de Zorn, Hugo Satre perçoit dans ces livres autant de fusils pointés qu’il fixe avec élégance.
22.95 $ / 18.00€
Les Éditions du Boréal
3970, rue Saint-Ambroise, Montréal (Québec), Canada H4C 2C7
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Tél: (514) 287-7401 Téléc: (514) 287-7664
Les photos des auteurs ne peuvent être reproduites sans l'autorisation des Éditions du Boréal.